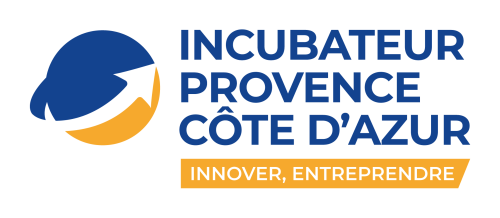La promesse de Solaya : une modélisation 3D haute qualité en quelques clics
Ce que propose Solaya ? Rendre on ne peut plus simple la modélisation 3D haute qualité d’un objet. Elle se fait en trois petites étapes. Un : poser l’objet sur une table ; avec un smartphone, le scanner en deux ou trois minutes en tournant autour pour le prendre sous tous les angles. Deux : passer le scan aux algorithmes d’IA optimisés pour maximiser la qualité du rendu. Trois : se connecter à la plateforme pour récupérer tous les contenus (3D, photos, vidéos). Vous avez alors en main des modèles 3D qui peuvent être utilisés notamment pour l’essayage virtuel ou pour présenter vos produits en 3D, photo ou vidéo sur votre site d’e-commerce
C’est ce secteur que Mariem Farhat et Massimo Moretti ont adressé en premier lieu avec Solaya. Ils l’avaient expérimenté avec ITAK, leur première entreprise, une agence dédiée à l’innovation et à la stratégie. La collaboration avec de grands groupes comme LVMH, Richemont, L’Oréal leur avait alors permis de comprendre en profondeur leurs besoins en termes de solutions efficaces et abordables pour la production de contenu.
Solaya apporte ainsi une réponse aux coûts souvent élevés des séances de shooting et de présentation des produits sur des sites web. Créée en 2024 à Nice, la société a travaillé notamment avec des chercheurs ayant participé à une équipe d’INRIA Sophia à l’origine d’une méthode mondialement utilisée pour les rendus en temps réel d’espaces. La technologie, de rupture, de Solaya a été adaptée pour les objets et optimisée pour satisfaire une clientèle haut de gamme avec une V0, lancée en début d’année.
Un bon départ. Lauréate des défis “Convergence IA” de France 2030 fin 2024, Solaya bénéficie du soutien de NVIDIA et de la BPI. Elle a reçu aussi un sérieux coup de pouce lors du dernier Vivatech où elle a été sélectionnée pour rejoindre ”LVMH Dreamscape”. Sa feuille de route ? Une seconde version, la V1, doit être lancée en octobre avec un UX repensé pour une capture encore plus simple. Solaya (20 personnes actuellement) va continuer sa R&D pour accélérer le processus de modélisation et surtout elle va chercher à adresser d’autres marchés qui utilisent la 3D : l’industrie, la défense, l’hôtellerie pour la captation d’espace, la fabrication additive, le spatial…Au programme également, conquérir le marché, se faire connaître en France et en Europe, et une levée de fonds pour ces nouvelles étapes.
Ce qu’elle attend de l’incubateur ? “Il nous a déjà connecté avec l’écosystème”, note Massimo Moretti. “Il nous aide aussi à renforcer les liens avec la BPI, avec les acteurs locaux et avec les banques pour le financement.”
Skyoros : une propulsion “verte” newspace pour les satellites
C’est un projet qui s’inscrit dans le secteur en pleine expansion du newspace : accélérer la décarbonation de l’industrie spatiale en créant, pour les satellites et véhicules spatiaux, une nouvelle génération de moteurs de propulsion utilisant un ergol “vert” connu. Cette question de la propulsion dans l’espace, Emmanuel Kot la connaît bien. Il a travaillé 20 ans dans un grand groupe de construction de satellites, dont 12 dans le domaine de la propulsion.
“La propulsion est vitale”, explique-t-il. “Quand un satellite est lancé dans l’espace, il doit pouvoir gagner sa position en orbite. Une position qu’il doit ensuite pouvoir maintenir. Et quand il est en fin de vie, il doit pouvoir sortir pour éviter de devenir un débris spatial. Actuellement, cette propulsion est assurée à partir d’un ergol toxique, cher à produire et à manipuler. Skyoros vise à construire une nouvelle génération de petits moteurs (ils tiennent dans une main) qui fonctionnent avec un ergol “vert”, bas carbone, qui ne demande pas de phase de transformation pour être produit et bon marché.”
Mais l’ambition de Skyoros va plus loin que le seul développement de ces nouveaux moteurs. Elle vise aussi à les construire avec la mise en place d’une petite usine (300 à 600 m2) avec des salles blanches. Ce nouveau type d’outil industriel se voudra agile et bas carbone.
Le projet Skyoros, qui s’intégrerait dans le campus spatial de Cannes, en est à ses débuts. La première phase qui est engagée tient dans le développement du moteur avec des contacts pris avec le principal laboratoire français. La société, ensuite, devrait être créée début 2026 et le POC (Proof of Concept) serait disponible d’ici 18 à 24 mois. Puis, il s’agit de poursuivre le développement et en parallèle de mettre en place l’outil industriel. Avec un enjeu fort à la clé : accélérer la transition écologique du secteur spatial, en proposant une solution à la fois écologique et décarbonée mais aussi performante, fiable et économique.
Ce qui est attendu de l’incubateur? Un accompagnement dans beaucoup de domaines : dans un premier temps la consolidation du business plan, la constitution de l’équipe opérationnelle, la recherche de partenariat avec les laboratoires et écoles, la recherche de partenaires financiers.
Pour Emmanuel Kot, après des années à laisser l’écologie de côté dans le secteur spatial, il est grand temps de passer à l’action.

SmartScan : les grandes oreilles de la cybersécurité des zones sensibles
SmartScan, comme le suggère son logo, ce sont en quelque sorte de grandes oreilles au service de la sécurité OT (Technologies Opérationnelles) des systèmes industriels et celle des Objets Connectés (IoT). Les progrès en miniaturisation et en connectivité ont ouvert de nouveaux risques d’espionnage et de cyberattaques. Pour y faire face, le projet SmartScan, qui entre en incubation après un essaimage au CEA, vise à produire et commercialiser des solutions souveraines de prévention et de réponse opérationnelle.
Ainsi, une première génération de détecteurs a permis de garantir l’absence de dispositif de communication sans fil dans une zone protégée. Le dispositif a été évalué avec succès sur plusieurs sites du CEA, et intégré dans ses procédures de sécurité.
Conseiller Cyber & IA au CEA, Régis Guyonnet, qui porte le projet, rappelle que la plupart des programmes de cybersécurité (Zero Trust, XDR…) négligent les menaces sans fil à l’extérieur de leur réseau. Pour lui, c’est là que commence le Far West. Les cybercriminels peuvent acheter des outils d’exfiltration de données, des brouilleurs et des dispositifs de surveillance en ligne pour une centaine d’euros, les smartphones peuvent être chargés avec des logiciels espions open source, et les attaques peuvent se produire sur de nombreux protocoles : Bluetooth, WiFi, IoT, cellulaire, et plus encore.
Le risque est patent. SmartScan, qui se présente comme une tablette tactile avec antennes dédiées, électronique, alimentation et logiciel a permis dans un premier temps de s’assurer que dans les zones protégées, là où tous les objets connectés sont interdits, il n’y a pas d’intrus cachés, smartphone, montre connectée ou autres. Il est également possible de détecter les appareils autorisés ou pas.
Le développement a commencé en 2018 et un premier prototype a été présenté à la Préfecture de Police de Paris. Ensuite, sous l’aile du CEA, le matériel a été expérimenté au Ministère des Armées. Mais depuis, huit autres cas d’usage ont été identifiés. SmartScan peut être très utile notamment dans les contrôles d’accès, pour rechercher des dispositifs cachés ou encore des personnes disparues victimes de catastrophes à partir de leurs appareils connectés.
Actuellement, les développements technologiques se poursuivent avec le centre civil du CEA à Grenoble. Un partenaire a été sélectionné pour sortir le premier produit d’ici 6 à 8 mois. L’équipe va se renforcer avec un directeur technique en cours de recrutement et des associés. En termes de marché, SmartScan vise le B2B d’abord au national puis au-delà des frontières. Autant d’opérations pour lesquelles l’accompagnement de l’incubateur est attendu.

AICO Technology : des puces bio-inspirées pour porter l’IA dans les drones, satellites, robots…
La deeptech AICO Technology, spin-off issue du LEAT lab (CNRS/Université Côte d’Azur), est un bel exemple de la synergie entre recherche publique et entrepreneuriat que permet et encourage l’écosystème sophipolitain. Pilotée par Edgar Lemaire, chercheur au CNRS passé entrepreneur, elle s’est spécialisée dans le développement de processeurs neuromorphiques (basés sur le fonctionnement du cerveau humain) et d’architectures matérielles pour l’intelligence artificielle embarquée ultra-basse consommation.
Son innovation phare, la technologie SPLEAT (SPiking Low-power Event-based ArchiTecture), est issue de plusieurs années de recherche au LEAT. Elle a été saluée, entre autres, par un SophIA Award au Sophia Summit 2023 et par un Grand Prix i-PhD en 2024. SPLEAT est révolutionnaire. Son architecture de calcul bio-inspirée est conçue pour permettre aux IA embarquées (drones, satellites, robots, wearables) de réaliser des tâches complexes (vision, traitement du signal, analyse vocale) tout en consommant 10 à 100 fois moins d’énergie que les accélérateurs traditionnels.
La puce SPLEAT se veut particulièrement adaptée aux systèmes autonomes ou aux systèmes contraints en énergie, où la réduction de la consommation électrique est un impératif pour l’endurance et la miniaturisation. AICO Technology propose ainsi du hardware IP et des modules silicium dédiés à l’IA, intégrables dans de nombreuses applications embarquées, spatiales ou industrielles, comme l’orchestration de satellites, le traitement local des flux vidéo, le pilotage de robots mobiles ou la reconnaissance vocale embarquée. D’où un énorme potentiel d’applications.
La société a été fondée le 12 juin 2025. “Notre équipe compte 4 personnes et nous envisageons de recruter six collaborateurs supplémentaires pour la Phase 1 avec la commercialisation de POC (Proof of Concept)” explique Edgar Lemaire. “Nous souhaitons ensuite sortir nos premières puces en pré-série à l’horizon Q3 2027, pour une entrée en mass production d’ici Q3 2028”.
Ce qui est attendu de l’incubateur ? La poursuite d’un accompagnement, déjà éprouvé lors d’une maturation entrepreneuriale activée notamment grâce au SophIA Awards, dans les décisions financières, juridiques, administratives, dans l’entrée sur le marché, dans le choix des bonnes directions du programme technologique.