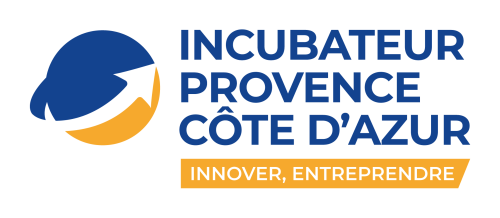De la recherche à la création d’entreprises innovantes, ils ont franchi le pas. Le 25ème anniversaire de la Loi sur l’Innovation et la Recherche, fêté en fin d’année dernière à Inria Sophia par l’Incubateur Provence Côte d’Azur, a donné l’occasion d’une grande revue de quelques belles deeptech lancées par des chercheurs azuréens passés du labo aux fourneaux. Les fondateurs et fondatrices de Cintoo, Mycophyto, Therapixel, Ecoat, Preventeo, Innofenso, Hoasys et de plusieurs autres sociétés sorties de travaux de recherche ont témoigné de leur parcours. Ils ont illustré du même coup ce que la loi, à l’origine des Incubateurs de la Recherche Publique, avait apporté. Des témoignages que l’on retrouvera dans cette galerie de portraits de chercheurs azuréens qui ont fait le choix de l’entreprise.
Reproduire la mer en laboratoire
Christophe Vasseur est l’un d’eux. Chercheur en océanographie spécialisé dans les microalgues, il est à l’origine de la création de deux agritech azuréennes : Inalve (microalgues pour la nourriture des écloseries marines) pour laquelle il a passé la main, et aujourd’hui Innofenso qui apporte des solutions de biocontrôle contre de multiples ravageurs agricoles à l’aide de micro-insectes. Voici son parcours.
“Scientifique de formation, je me suis intéressé à la biologie des océans et en particulier aux microalgues en Arctique dans les “polynies”, ces zones polaires qui restent libres de glace et offrent l’un des écosystèmes les plus productifs de l’Arctique. Mon doctorat a été passé en 2003 et suite à cette expérience une question s’est posée : comment faire bénéficier la société de ces mécanismes biologiques spécifiques ? Entré au CNRS, j’ai cherché d’apporter une réponse en reproduisant la mer en laboratoire et en essayant d’y faire pousser des algues.”
Du marché des biocarburants à celui de l’aquaculture
“Le premier projet de recherche portait sur l’utilisation de ces algues pour des biocarburants. Cela a bien fonctionné en laboratoire, mais n’a finalement pas percé dans la vraie vie. Ayant quitté le CNRS en 2011, j’ai été recruté par Algenol, une biotech américaine qui s’était lancée dans l’industrialisation de la production de microalgues pour du biocarburant. En dépit des investissements, cette technologie n’a pas pu s’imposer sur le marché. Revenu en France au bout de trois ans, je me suis rapproché d’Inria Sophia et j’ai réfléchi à une utilisation pour l’alimentation animale qui permettrait aussi de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire. Le choix s’est fait sur l’aquaculture. Inalve a été créée en 2016, mais il a fallu six ans, 6 M€ investis et un pivot sur les écloseries (la valeur ajoutée de nos produits y était plus importante) pour trouver le marché.”
Il y a trois ans, Christophe Vasseur a passé la main à Véronique Raoul pour se lancer dans une autre aventure entrepreneuriale : Innofenso. “Je voulais m’engager dans un produit associé au développement durable et développer une technologie française. La rencontre avec Nicolas Ris, un chercheur de l’Inrae, et son équipe, a été déterminante. Nous avons décidé de créer Innofenso. Notre objectif était d’assurer une protection des plantes pour maintenir une production végétale alimentaire tout en supprimant les pesticides. A partir d’une technologie issue de dix ans de recherche à l’Inrae, l’équipe a pour cela développé des cocktails d’insectes.”
“La société a été créée en janvier 2024. Mais grâce à la longue réflexion que nous avions eu en amont, nous avons pu nous placer rapidement sur le marché en convainquant trois filières agricoles de tester nos produits directement dans les champs. Une rapidité de mise sur le marché importante pour nous : il s’agit de montrer comment la technologie peut améliorer le quotidien et changer les choses tout de suite. Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves”.
Ce qu’a apporté la Loi sur l’Innovation
“Le passage en incubation, structurant, bien sûr, le prix d’innovation i-Lab aussi. Globalement, la loi a créé un cadre favorable à mon parcours entrepreneurial facilitant la création et le développement des sociétés de biotechnologies que j’ai fondées depuis près de 15 ans.
Elle m’a permis d’impliquer un chercheur du secteur public dans la création d’une entreprise innovante tout en maintenant son emploi public. Ce qui a sécurisé son parcours entrepreneurial et limité les risques financiers. Cette mesure permet de transformer ses découvertes scientifiques en innovations commercialisables.”
“Par ailleurs la mise en place du CIR et son soutien aux importantes dépenses de R&D a été une source non-négligeable de financement en particulier dans les phases critiques de démarrage et de croissance. Cela m’a offert une surface financière facilitant certaines décisions stratégiques.”
“Enfin, le fonds pour l’innovation m’a permis de cofinancer les premières étapes des projets d’innovation de rupture au travers de subventions, prêts et avances remboursables, mais également d’entrée au capital et ce selon les niveaux de maturité des sociétés que j’ai fondées. Le tout permettant, in fine, aux innovations de pénétrer leurs marchés. Aquaculture et agriculture dans mon cas.”
“Ces mesures ont grandement facilité les démarches de la création de mes sociétés de biotechnologie dites Deep tech, mais des efforts restent nécessaires pour lever les freins culturels et financiers, notamment en renforçant le capital-risque et en sensibilisant davantage les chercheurs à l’entrepreneuriat.”